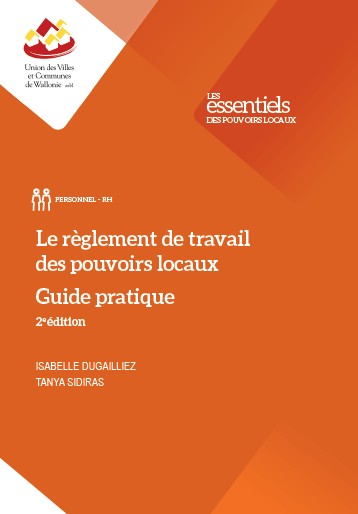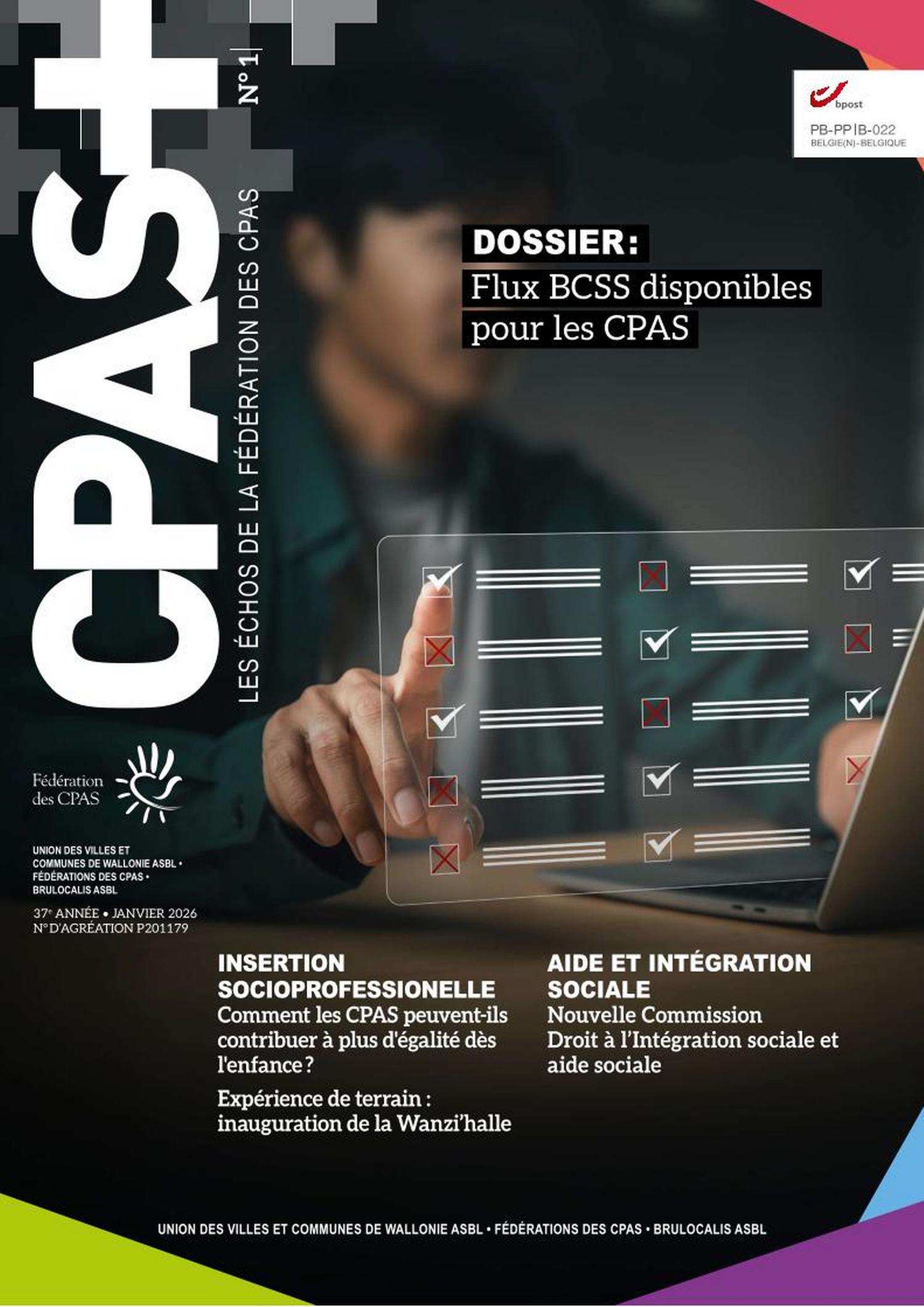L'organisation de l'enseignement en FWB
1. L'Enseignement Fondamental Ordinaire
A. Cadre général et finalités
L'enseignement fondamental ordinaire constitue le premier maillon du système éducatif en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Il se compose de deux niveaux : l'enseignement maternel (M1 à M3, dès 2 ans et demi) et l'enseignement primaire (P1 à P6, de 6 à 12 ans). L'ensemble forme un parcours de neuf années, destiné à accueillir tous les enfants sans distinction et à leur garantir un socle commun d'apprentissages. Depuis l'avis n° 3 du Pacte pour un Enseignement d'excellence (mars 2017), l'enseignement fondamental s'inscrit dans le cadre de ce Pacte qui a introduit des réformes majeures dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement et de réduire les inégalités entre élèves. Les écoles doivent se doter d'un plan de pilotage formalisé en contrat d'objectifs à atteindre (cycle de 6 ans). Depuis la rentrée 2025-2026, le tronc commun est généralisé de la première maternelle à la sixième primaire. Cette réforme a l'ambition de mettre fin à certaines logiques sélectives précoces et vise à offrir à chaque élève une égalité réelle dans l'accès aux savoirs.
L'enseignement fondamental a pour finalité de développer chez chaque enfant les compétences nécessaires à la vie en société et à la poursuite de son parcours scolaire. Il met l'accent sur le développement global de l'élève, à la fois intellectuel, physique, artistique et social. Différents textes légaux en ont fixé les grandes orientations. Elles traduisent une volonté politique et sociale de former des citoyens critiques, responsables et capables de contribuer activement à la société démocratique. Les valeurs qui sous-tendent l'enseignement fondamental sont celles de l'égalité des chances, de l'inclusion, de la diversité culturelle, et du respect du rythme de chaque enfant.
B. Organisation pédagogique et suivi des élèves
L'organisation pédagogique de l'enseignement fondamental repose sur huit grands domaines d'apprentissage dont la langue et la communication, les mathématiques, les sciences, les arts, l'éducation physique et la santé, la formation citoyenne, le numérique et les compétences transversales (article 1.4.2-3 du Code de l'enseignement du 3.5.2019). Les référentiels de compétences interréseaux, élaborés dans le cadre du Pacte d'excellence, assurent une progression structurée et harmonisée dans chacun de ces domaines, de la maternelle jusqu'à la fin du tronc commun. Ces référentiels garantissent que tous les élèves acquièrent progressivement les mêmes compétences, quel que soit le réseau d'enseignement ou l'école fréquentée. Si les référentiels définissent le "quoi" (les savoirs, savoir-faire et compétences à acquérir), les programmes de cours proposés par les réseaux définissent le "comment" (les outils, les conseils méthodologiques et les pistes pour enseigner les savoirs).
Afin de mieux répondre aux besoins diversifiés des élèves, un dispositif d'accompagnement personnalisé a été instauré. Il prévoit un renforcement de l'encadrement à raison de quatre périodes hebdomadaires en première et deuxième primaire, et deux périodes de la troisième à la sixième primaire. Cet accompagnement permet de proposer du coenseignement, de la différenciation pédagogique et des aides ciblées, afin de soutenir les élèves en difficulté et de favoriser leur progression. Parallèlement, une attention particulière est portée à l'éducation physique et à la santé, qui disposent de trois périodes hebdomadaires dès la cinquième année primaire. Cette mesure reflète l'importance accordée au bien-être physique et mental des enfants, considérés comme des conditions essentielles à la réussite scolaire.
Le suivi des apprentissages repose sur plusieurs outils. Le Dossier d'Accompagnement de l'Élève (DAccE), obligatoire de M1 à P6, assure une traçabilité du parcours scolaire de chaque élève et devrait permettre une collaboration plus efficace entre enseignants. Des bilans réguliers sont établis pour informer les familles et ajuster les pratiques pédagogiques. En fin de sixième primaire, les élèves passent l’épreuve externe commune, qui sanctionne l’acquisition des compétences et débouche sur l’obtention du Certificat d’Études de Base (CEB). En cas de difficultés persistantes, le parcours de l’élève peut bénéficier d’un maintien exceptionnel. Il peut être envisagé, mais seulement après épuisement des dispositifs de remédiation. Cette possibilité, n’était auparavant pas régulée. Il en va de même pour un avancement en cours de cursus scolaire.
C. Organisation scolaire et vie à l’école – Présentation non exhaustive
Le calendrier scolaire
La vie quotidienne dans l’enseignement fondamental est rythmée par un calendrier scolaire fixé à 182 jours. Toutefois, le gouvernement peut fixer celui-ci entre 180 et 184 jours. Les nouvelles modalités de rythmes scolaires, introduites en 2022, imposent des séquences de sept à huit semaines de cours suivies de deux semaines de congé. Cette organisation, basée sur les apports de la science, vise à mieux respecter les besoins physiologiques des enfants et à favoriser une meilleure répartition de l’apprentissage dans l’année.
L'obligation scolaire
La scolarité est obligatoire concerne tous les élèves âgés de minimum 5 ans au plus tard le 31 décembre de l’année scolaire en cours.
Les changements d’école
Les changements d’école ont été simplifiés, notamment par la disparition du système de cycles, ce qui offre plus de souplesse entre deux années scolaires. En revanche, ils sont régulés en cours d’année scolaire.
La taille des classes
Elle est strictement encadrée. En première et deuxième primaire, les classes ne peuvent excéder 24 élèves, tandis que, de la troisième à la sixième année primaire, la limite est fixée à 28 élèves (29 dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale et communes wallonnes à statut linguistique spécial). Un mécanisme d’octroi de périodes complémentaires est prévu en cas de dépassement à la taille des classes, afin d’assurer un encadrement pédagogique suffisant.
Les travaux à domicile
Dans l’organisation du travail de l’élève, la question des travaux à domicile est également encadrée : ils sont interdits en maternelle et introduits progressivement dans l’enseignement primaire, afin de respecter l’équilibre entre vie familiale, les activités extrascolaires et les apprentissages scolaires.
Le cours de philosophie et citoyenneté, de morale non confessionnelle et de religion
Dans les écoles officielles subventionnées, le cours de philosophie et citoyenneté est organisé à raison d’un période par semaine. En outre, les élèves bénéficient d’une période de cours de morale non confessionnelle ou l’une des religions reconnues par l'Etat belge ou d’une période de cours de philosophie et citoyenneté supplémentaire en cas de demande de dispense du suivi d’un cours philosophique.
Les associations de parents et le conseil de participation
La vie scolaire repose également sur l’implication des familles et de la communauté éducative. Les associations de parents et le Conseil de participation jouent un rôle central dans la concertation et l’orientation de la vie de l’école.
D. Moyens, encadrement et enjeux
L’enseignement fondamental bénéficie de moyens humains, matériels et financiers encadrés par des dispositifs précise. Les calculs d’encadrement sont réalisés à l’aide de l’application PRIMVER de la FWB, qui permet de calculer l’encadrement des implantations et écoles. Des mesures d’encadrement différencié viennent renforcer les moyens des écoles accueillant des populations particulièrement fragilisées (à indice socio-économique plus faible), tandis que des dispositifs spécifiques comme le FLA (Français langue d’apprentissage) ou le DASPA (Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés) visent les élèves primo-arrivants ou issus de milieux allophones. Des périodes complémentaires peuvent également être accordées pour de projets spécifiques.
Les écoles bénéficient de subventions pour leur fonctionnement quotidien, la mise en œuvre de la gratuité scolaire, l’organisation de la surveillance du temps de midi, ainsi que pour soutenir les directions dans leurs tâches administratives. La gratuité scolaire est strictement encadrée : seules certaines dépenses peuvent être demandées aux familles, et les écoles ont l’obligation de fournir une estimation annuelle et une ventilation claire des frais. Ces exigences garantissent la transparence et limitent les inégalités d’accès aux activités scolaires.
Le suivi administratif repose sur un calendrier précis d’échéances à respecter pour l’encodage des données dans différents outils numériques de la FWB tels que SIEL, OBSI, le DAccE ou le PLAF. La rigueur dans cette gestion est essentielle pour le bon fonctionnement des écoles et le financement correct des moyens attribués. Les défis actuels sont nombreux : la mise en œuvre complète du tronc commun, la réduction des inégalités sociales et de la fracture numérique, la gestion des populations scolaires hétérogènes et le respect des normes de classes. La pénurie de certains profils enseignants, notamment dans l’enseignement des langues et parmi les maîtres spéciaux, constitue un autre enjeu majeur. En conclusion, l’enseignement fondamental ordinaire représente le socle de tout le système éducatif. Il est à la fois un lieu d’apprentissages, d’éducation citoyenne et d’émancipation, appuyé sur un cadre administratif solide et des valeurs de justice et d’inclusion.
Pour en savoir plus :
| L’enseignement fondamental sur www.enseignement.be |  |
| La circulaire 9541 du 4 juillet 2025 relative à l’organisation de l’enseignement fondamental ordinaire pour l’année scolaire 2025-2026 |  |
2. L'Enseignement spécialisé
L'enseignement spécialisé de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’adresse aux enfants et aux jeunes présentant des besoins éducatifs particuliers. Son objectif est d’offrir à chaque élève un cadre d’apprentissage adapté, sécurisé et ambitieux, afin qu’il progresse à son rythme et trouve sa place dans la société. Pour y parvenir, le système combine trois clés d’organisation : les types d’enseignement (qui décrivent le profil de besoins), une structuration spécifique au fondamental (maternelle et primaire), et des différentes formes d’enseignement au secondaire. Autour de ce cœur, des dispositifs ciblés (p. ex. classes à visée inclusive, alternance, stages) assurent la continuité de parcours, y compris lorsque la situation médicale, sociale ou scolaire complique une scolarité dite classique.
A. Qui peut s’inscrire et à quelles conditions ?
L’accès à l’enseignement spécialisé est encadré pour garantir que l’élève s’y trouve parce que c’est nécessaire, et non par défaut. D’abord, des conditions d’âge s’appliquent : l’inscription est possible à partir de 2 ans et 6 mois et jusqu’à 21 ans. Des exceptions existent toutefois dans des cas spécifiques – par exemple, pour certains élèves de forme 3 qui entament la troisième phase pour la première fois au-delà de 21 ans, ou encore pour des élèves de type 7 (déficience auditive) pouvant être accueillis avant 2 ans et 6 mois lorsque l’évaluation spécialisée le justifie.
Ensuite, l’inscription est subordonnée à un rapport d’inscription, document central établi par un centre PMS ou par un organisme reconnu par la FWB. Ce rapport identifie le Type d’enseignement spécialisé correspondant aux besoins réels de l’élève en s’appuyant sur un faisceau d’informations (médicales, psychologiques, pédagogiques et socio-familiales).
Selon les Types, des conditions spécifiques s’ajoutent : actuellement pour les types 1, 3 et 8, il faut établir que les aménagements raisonnables mis en place dans l’enseignement ordinaire se sont révélés insuffisants ; pour le type 5, un examen médical établi par un pédiatre ou un médecin référent est requis ; pour les types 6 et 7, un examen spécialisé mené respectivement par un ophtalmologue ou un ORL est indispensable.
Le Gouvernement peut, dans des cas spécifiques, accorder des dérogations (par exemple un maintien au-delà de 21 ans ou une inscription dans un autre type). Enfin, si un élève quitte l’enseignement spécialisé puis revient dans un délai de moins de deux ans, un nouveau rapport n’est pas exigé (sauf réorientation vers un autre type).
B. Le fondamental spécialisé : maternelle ≠ primaire
Le fondamental spécialisé couvre la maternelle et le primaire, mais ne les organise pas de la même manière. C’est ici que l’on corrige un malentendu fréquent : les « maturités » ne s’appliquent qu’au primaire spécialisé. La maternelle spécialisée n’est pas organisée en maturités.
En maternelle spécialisée, on travaille d’abord les bases du développement : communication et langage, socialisation, autonomie au quotidien, motricité, exploration sensorielle, premiers repères logiques et temporels. Les groupes sont de petite taille, le matériel est adapté, et les interventions d’une équipe pluridisciplinaire permettent d’ajuster très tôt les réponses éducatives.
En primaire spécialisé, la progression ne suit pas des années d’études classiques mais des degrés de maturité. L’élève avance lorsqu’il maîtrise les compétences attendues, sans être contraint par son âge. Le type 2 suit une organisation spécifique par paliers (autonomie et socialisation ; préscolaire ; premiers apprentissages ; approfondissements), tandis que les autres types privilégient une trajectoire allant des apprentissages préscolaires à l’utilisation fonctionnelle des acquis.
| Cycle | Types organisés | Maturité / Certification | Détails clés |
|---|---|---|---|
| Maternelle spécialisée | 2, 3, 4, 5, 6, 7 (pas de type 1 ni 8) |
Aucune maturité | Objectif : développement global, sans certification. |
| Primaire spécialisée Tous sauf type 2 |
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 4 degrés de maturité : I préscolaire II éveil III maîtrise & développement IV utilisation fonctionnelle |
CEB accessible Orientation vers l’enseignement ordinaire ou spécialisé selon modalités. |
| Primaire spécialisée type 2 |
Type 2 uniquement | 4 degrés adaptés : I autonomie/socialisation II préscolaire III premiers apprentissages IV approfondissement |
Orientation majoritairement vers secondaire spécialisé. |
C. Des dispositifs adaptés à des situations particulières
Certaines réalités exigent des réponses très spécifiques. C’est le cas du type 5, destiné aux élèves hospitalisés ou temporairement éloignés de leur école pour raison médicale. Les écoles de type 5 assurent la continuité des apprentissages et maintiennent le lien avec l’établissement d’origine, afin d’éviter la rupture scolaire et de préparer la réintégration. Autre exemple : les classes à visée inclusive, qui accueillent un petit nombre d’élèves (principalement des types 2 ou 3, parfois avec autisme) pour leur permettre de fréquenter partiellement l’ordinaire tout en bénéficiant d’un encadrement renforcé.
D. Le secondaire spécialisé : quatre formes
Au secondaire, l’enseignement spécialisé est structuré en Formes qui correspondent à des finalités claires. La forme 1 vise l’autonomie sociale (vie quotidienne adaptée). La forme 2 combine autonomie sociale et insertion en milieu de travail protégé. La forme 3 prépare à l’insertion dans l’emploi ordinaire grâce à une formation générale, sociale et professionnelle, des stages obligatoires et une organisation en alternance école-entreprise est également possible. Enfin, la forme 4 correspond à un enseignement équivalent à l’ordinaire, avec les adaptations nécessaires, et conduit aux mêmes certifications (CESS, Certificat de Qualification).
La participation aux stages en forme 3 (dès la 2e phase et en 3e phase) est obligatoire et certificative : ils permettent d’observer, d’apprendre puis de mettre en responsabilité l’élève sur des tâches professionnelles, dans un cadre balisé. L’alternance (formes 3 et 4) organise la semaine entre cours et entreprise, et prépare de façon concrète à l’emploi.
| Formes | Types d’enseignement organisables | Types d’enseignement | Finalité |
|---|---|---|---|
| Forme 1 – Insertion sociale | Types 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Enseignement adapté qui vise l’autonomie et la socialisation vers des lieux de vie adaptés selon les compétences du jeune. | Pas de diplôme certificatif ; autonomie et insertion sociale. |
| Forme 2 – Vie sociale & pré-pro |
Types 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Enseignement adapté qui vise l’autonomie et la socialisation vers des lieux de vie adaptés ou un milieu de travail adapté selon les compétences du jeune. | Pas de diplôme certificatif ; préparation à la vie sociale et au travail adapté (ETA par ex.) |
| Forme 3 – Enseignement qualifiant | Types 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Technique & professionnel (pas de général) | Certifications professionnelles (CQ, parfois CESS). |
| Forme 4 – Plein exercice | Types 3, 4, 5, 6, 7 | Même niveau que l’enseignement Général, technique, artistique, professionnel, mais adapté aux besoins du jeune. | Diplômes identiques à l’ordinaire (CE1D, CE2D, CESS, CQ). |
E. Transitions et réinscriptions
Le parcours d’un élève n’est pas une ligne droite. Il évolue avec ses acquis, sa santé, son contexte familial. L’enseignement spécialisé prévoit des réorientations (avec mise à jour du rapport du CPMS) et encourage, chaque fois que c’est réaliste et bénéfique, des retours progressifs vers l’enseignement ordinaire.
Pour en savoir plus :
3. Le subventionnement dans l’enseignement
Le financement de l’enseignement subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles repose sur plusieurs piliers visant à garantir à la fois l’équité et l’efficacité.
A. Subventions de fonctionnement
Elles couvrent les frais liés au matériel, aux fournitures scolaires et à l’équipement des écoles. Leur montant dépend du nombre d’élèves inscrits et est ajusté annuellement. Un mécanisme de solidarité redistribue une partie des moyens entre écoles selon leur contexte socio-économique et leur taille. Ces subventions prennent aussi en charge certains coûts spécifiques (gratuité, entretien des locaux, prévention, encadrement différencié dans l’enseignement fondamental ordinaire…).
B. Subventions-traitements
Elles concernent les rémunérations des membres du personnel (enseignants, directions, paramédicaux, sociaux, administratifs). Les fonctions subventionnées sont définies par la réglementation, selon les niveaux d’enseignement. L’encadrement (nombre d’emplois ou de périodes) est calculé en fonction du nombre d’élèves et peut être, sous certaines conditions, réajusté en cours d’année pour coller à la réalité du terrain.
C. Subventionnement des infrastructures scolaires
La FWB soutient également les investissements immobiliers des écoles. Les projets doivent répondre à des normes strictes (sécurité, accessibilité, durabilité, performance énergétique, rationalisation des implantations). Le financement vise en priorité les situations urgentes, les établissements accueillant des publics défavorisés, ainsi que la création de places supplémentaires. De nouvelles règles organisent la répartition des moyens, l’introduction des dossiers et les conditions de suivi.
4. Les Pôles Territoriaux : Un Soutien à l'Inclusion Scolaire
Les pôles territoriaux sont des structures clés qui œuvrent à l'inclusion des élèves à besoins spécifiques[1] au sein de l'enseignement ordinaire. Ils se positionnent aux côtés des écoles d'enseignement ordinaire et spécialisé pour offrir un accompagnement ciblé et soutenir les efforts des équipes éducatives.
A. Missions principales des pôles territoriaux
Les pôles articulent leurs actions autour de deux catégories de missions essentielles :
- Missions à caractère individuel : Elles concernent l'accompagnement direct des élèves à besoins spécifiques. Il s'agit notamment des élèves bénéficiant d'un protocole d'aménagements raisonnables (adaptations individualisées pour faciliter l'apprentissage d’élèves diagnostiqués à besoins spécifiques) ou d'une intégration permanente totale (scolarisation complète d’élèves issus de l’enseignement spécialisé en enseignement ordinaire avec un soutien adapté).
- Missions à caractère collectif : Ces missions visent à soutenir les écoles d’enseignement ordinaire coopérantes, leurs équipes éducatives, les élèves et leurs parents. Cela se traduit par des conseils, des informations, et la mise à disposition d'outils liés aux aménagements raisonnables et à l'intégration permanente totale.
B. Fonctionnement et conventionnement des pôles
Chaque pôle est rattaché à une école-siège, à savoir une école d'enseignement spécialisé (fondamental ou secondaire). Pour exister, ces écoles-sièges ont dû contractualiser avec des écoles coopérantes issues de l'enseignement ordinaire (fondamental et/ou secondaire) afin d’atteindre un quota minimal d’élèves défini par la FWB. Les interventions des pôles se limitent ainsi aux écoles avec lesquelles ils ont conventionné. Ce processus de contractualisation lie les écoles sièges et coopérantes jusqu'à la fin du contrat d'objectifs de l'école-siège. Une école coopérante ne peut donc pas rejoindre un autre pôle territorial en cours de contrat. À l'échéance de ce contrat, de nouvelles conventions doivent être conclues pour que les pôles puissent continuer leurs missions, si le quota minimal d’élèves pour exister est atteint.
C. Composition et encadrement des équipes pluridisciplinaires
Pour mener à bien leurs missions, les pôles territoriaux s'appuient sur une équipe pluridisciplinaire. Cette équipe est composée de professionnels de divers horizons : directeurs et enseignants, personnel paramédical, social, psychologique et auxiliaire d'éducation. Le personnel peut provenir ou non d’écoles d’enseignement ordinaire ou spécialisé afin de garantir une expertise variée répondant à l’éventail de besoins spécifiques. Ces équipes sont supervisées par un coordonnateur de pôle, qui reste sous la responsabilité du directeur de l'école siège.
D. Financement des pôles territoriaux
Le financement des pôles est assuré par la FWB via un système d'enveloppe de points. Chaque élève régulièrement inscrit au 15 janvier dans une école coopérante génère un point pour le pôle concerné. Des points supplémentaires sont attribués pour les élèves en intégration permanente totale ou pour les élèves à besoins spécifiques sensorimoteurs[2] (des paliers de points basés sur l'importance de la déficience et son impact sur l'environnement scolaire).
Les pouvoirs organisateurs doivent ensuite convertir cette enveloppe de points en :
- Subvention-traitement : Allouée à l'engagement des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire (un minimum de 80% de l'enveloppe).
- Frais de fonctionnement : Destinés au fonctionnement et à l'équipement du pôle territorial (un maximum de 20% de l'enveloppe).
E. Gestion administrative et informatique
La gestion administrative des pôles est centralisée via l'application « e-pôles ». Cette plateforme est alimentée par les informations disponibles dans le Système d'Information des Élèves (SIEL) et par les encodages effectués par les coordonnateurs de pôle ou leurs délégués. L'accès pour les pouvoirs organisateurs des écoles coopérantes est, en revanche, plus limité.
Pour en savoir plus :
| Les pôles territoriaux sur www.enseignement.be |  |
| La circulaire 9545 du 11 juillet 2025 - Circulaire de rentrée des pôles territoriaux - Année scolaire 2025-2026 |  |
5. L'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit
A. Cadre général et finalités
L’enseignement secondaire artistique à horaire réduit (ESAHR) fait partie de l’enseignement non obligatoire subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Il comprend 4 domaines : les arts plastiques, visuels et de l’espace, la musique, les arts de la parole et du théâtre, et la danse.
L’ESAHR accueille les élèves à partir de 5 ou 6 ans selon les domaines, et s’adresse tant aux enfants qu’aux adultes.
La grande majorité des établissements font partie du réseau communal. Mais l’une des particularités de l’ESAHR est de compter un nombre important d’implantations dont de nombreuses situées hors territoire communal.
L’ESHAR à pour finalités principales de :
- concourir à l'épanouissement des élèves en promouvant une culture artistique par l'apprentissage des divers langages et pratiques artistiques ;
- donner aux élèves les moyens et formations leur permettant d'atteindre l'autonomie artistique suscitant une faculté créatrice personnelle ;
- offrir un enseignement préparant des élèves à rencontrer les exigences requises pour accéder à l'enseignement artistique de niveau supérieur.
B. Organisation pédagogique et suivi des élèves
L’organisation pédagogique de l’ESAHR comprend une distinction entre cours de base et cours complémentaires.
Les cours de base sont divisés en 4 filières : préparatoire, formation, qualification et transition. A l’exception de la filière préparatoire, une évaluation certificative est prévue en fin de chaque filière. Un certificat est décerné à l’issue des filières de formation et de qualification, alors qu’un diplôme est décerné à l’issue de la filière de transition.
Des conseils de classe et d’admission présidés par la direction de l’établissement, assurent le suivi pédagogique des élèves et la sanction des études, en délivrant, après délibération, les certificats et diplômes.
Les cours complémentaires sont organisés en années d’études dont la fréquentation est souvent illimitée dans le temps. Ces cours ne font pas l’objet d’une évaluation mais d’une validation selon les conditions déterminées par les conseils de classe et d’admission.
Un référentiel de compétences sert de base à l’enseignement de chaque discipline, qui ont chacune leur programme de cours rédigé soit par le pouvoir organisateur, soit par le CECP (programmes inter réseaux auquel le pouvoir organisateur peut adhérer).
C. Gestion administrative et organisation scolaire
Pour l’ESAHR, l'année scolaire débute et se termine en fonction du nombre de semaines de fonctionnement de l’établissement.
Pour les établissements fonctionnant en 37 semaines, le calendrier est calqué sur celui de l’enseignement obligatoire, alors que pour les établissements fonctionnant en 29 ou 33 semaines, la rentrée doit avoir lieu au plus tard le 15 septembre et la fin d’année scolaire au plus tôt le 1er juin.
La date limite d'inscription des élèves se situe 30 jours après la rentrée.
L’inscription est gratuite pour les moins de 12 ans.
A partir de 12 ans, un droit d'inscription fixé par la Fédération Wallonie-Bruxelles est demandé, le montant de ce droit étant majoré pour les plus de 18 ans.
Des exemptions ou des réductions sont possibles pour certaines catégories d'élèves, comme les étudiants, les demandeurs d'emploi ou les bénéficiaires de l'intervention majorée.
L’inscription d’un élève fait l’objet d’un dossier comprenant la copie d’une pièce d'identité ainsi que les documents justificatifs en cas d’exemption.
Les dossiers doivent être mis à disposition du service de vérification sur demande.
Les conditions d’accès aux cours comprennent notamment l’obligation de suivre toutes les périodes prévues pour chacun des cours, le taux d’absences injustifiées étant fixé à 20%.
Le nombre minimum de périodes hebdomadaires de cours pour assurer la régularité des élèves varie, selon les domaines et les filières, de 1 à 8.
Les présences et absences des élèves sont consignées dans un registre propre à chaque classe.
A partir de l'année scolaire 2025-2026, l'utilisation de la plateforme informatique SIEL ESAHR est généralisée pour tous les établissements afin de faciliter la transmission des données concernant l'inscription et la régularité des élèves à la FWB.
Chaque établissement établit, selon les modalités décrétales, et envoie à l'administration début octobre :
- La liste des cours qu'il organise et la répartition des dotations dans chaque domaine.
- Les grilles horaires des cours, ainsi que celles du personnel enseignant et non enseignant.
Chaque établissement peut aussi, sur sa dotation et après approbation d'un dossier par l'administration, engager un ou plusieurs intervenants pour des tâches spécifiques non reprises dans la liste des cours organisables.
Pour en savoir plus :
| L’ESAHR sur www.enseignement.be |  |
| La circulaire 9540 du 3 juillet 2025 relative à l’organisation de l’enseignement artistique à horaire réduit pour l’année 2025-2026 |  |
[1] Un besoin reconnu résultant d'une particularité, d'un trouble ou d'une situation permanente ou semi-permanente (psychologique, mentale, physique, psychoaffective) qui fait obstacle au projet d'apprentissage et nécessite un soutien supplémentaire au sein de l'école pour un parcours scolaire harmonieux en enseignement ordinaire ou spécialisé.
[2] Un besoin spécifique résultant uniquement de déficiences physiques, visuelles et/ou auditives.

Focus sur la commune
Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec le SPW-IAS pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.
Téléchargez cette fiche en PDF Découvrez l'ouvrage complet