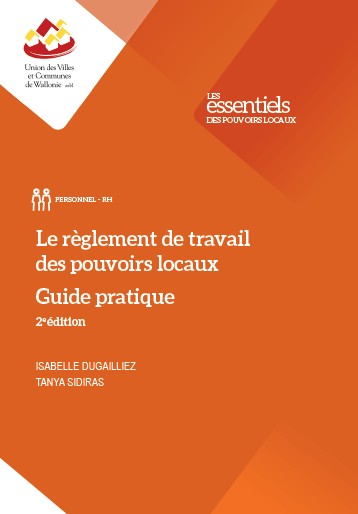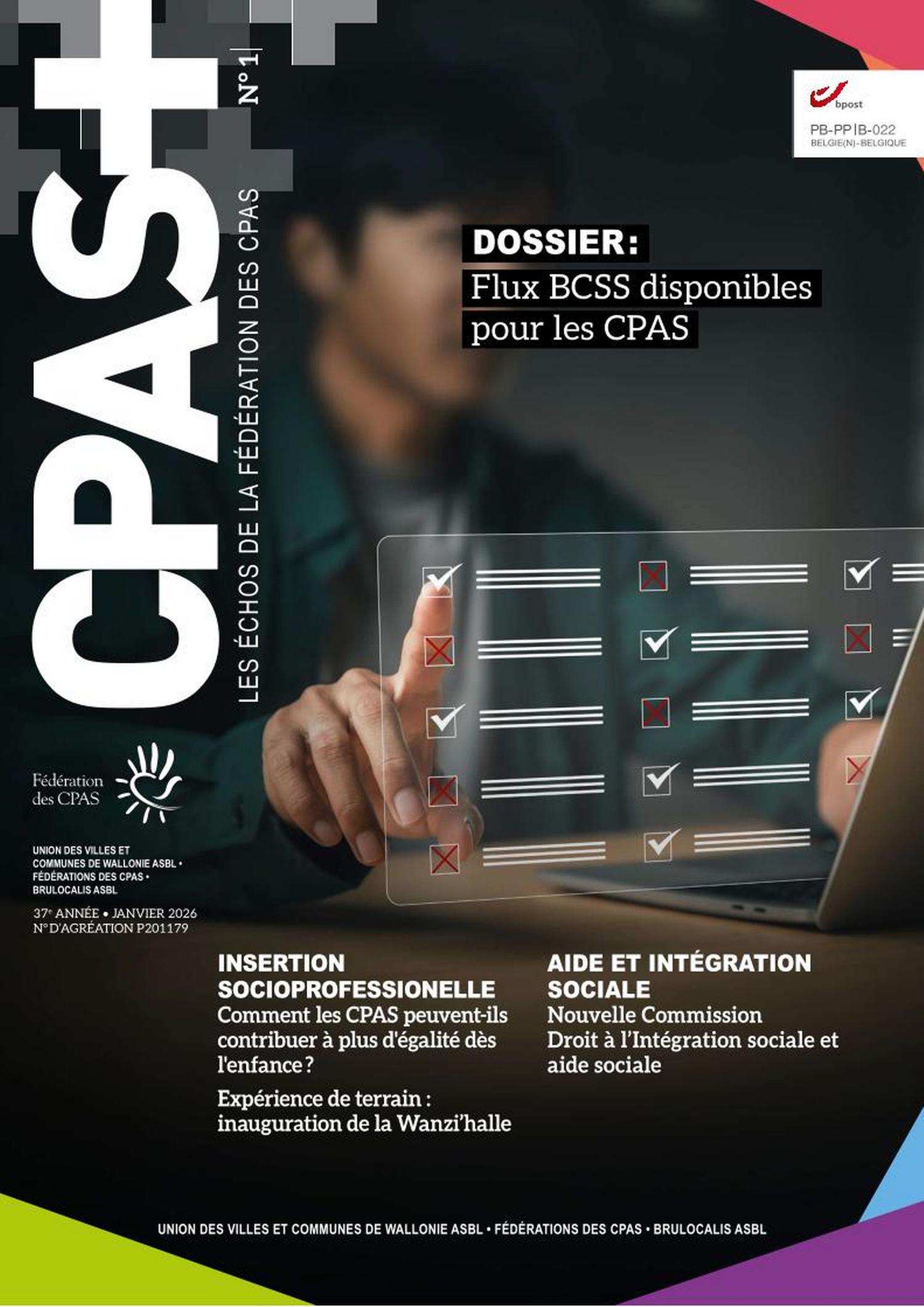Le transport de personnes par la route
1. Transports en commun
Les transports en commun constituent un outil essentiel pour le développement d'une politique intégrée de gestion de la mobilité à l'échelle de la commune. Il s’agit d’un enjeu de plus en plus important pour permettre, en milieu urbain, de trouver une solution aux problèmes de congestion ou de stationnement et, en milieu rural, d’offrir une accessibilité aisée aux services et au territoire.
Le transport de personnes est une activité soumise à autorisation et la mise en place d'un service de transport est soumise à des conditions d'exploitation. La commune peut ainsi développer des services de transport ponctuellement et sous certaines conditions, ou développer des services de transport régulier, en collaboration avec les TEC.
Les services des TEC constituent cependant l'offre de transport en commun de base, complémentairement à l'offre de la SNCB.
A. L'Autorité organisatrice des transports (AOT) et l'Opérateur de transport de Wallonie (OTW)
En mars 2018, un décret relatif au service de transport public de personnes a largement modifié le système wallon du transport en commun et mis en place une nouvelle gouvernance de celui-ci pour davantage d’efficacité et de pertinence.
Avec cette réforme est créé un Opérateur de transport de Wallonie (OTW). Celui-ci reprend les droits des cinq sociétés d’exploitation TEC (TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut, TEC Liège-Verviers et TEC Namur-Luxembourg) et de l’ancienne SRWT. Toutefois, les TEC restent la marque commerciale du Groupe. L’OTW a pour missions l’étude, la promotion, l’établissement et l’exploitation des services de transport public des personnes et est chargé d’opérationnaliser les services réguliers de transport en commun.
Une Autorité organisatrice de transport (AOT) est instituée. Elle est intégrée au Service public de Wallonie et a entre autres pour mission de traduire la vision du Gouvernement en une politique d'accessibilité au territoire et en objectifs opérationnels, et d’assurer la concertation avec les parties prenantes locales, régionales et fédérales en vue de mettre en œuvre la politique d'accessibilité. Le décret lui confie donc une mission d’organisation, de régulation et de surveillance du transport en commun wallon.
La notion de bassin de mobilité est introduite dans l’arrêté du Gouvernement wallon afin de tenir compte des particularités locales. Il est décrit de la manière suivante : « une circonscription géographique comprenant plusieurs territoires communaux résultant de l'existence d'un ou de plusieurs pôles d'attraction vers lesquels les habitants du bassin se déplacent quotidiennement, étant entendu que les déplacements internes au bassin de mobilité sont plus importants que les déplacements vers ou depuis l'extérieur de ce même bassin ». Ce concept est important, car il devrait orienter la réflexion et les décisions en matière de dessertes et de liaisons existantes et à créer.
À titre d’information, les TEC parcourent chaque année plus de 120 millions de kilomètres pour transporter plus de 125 millions de voyageurs, qui embarquent depuis l'un des 32.137 arrêts implantés sur tout le territoire de la Région wallonne[1].
B. Le rôle des communes
Les communes détiennent des actions qui leur confèrent uniquement le droit de nommer un représentant à l’organe de consultation des bassins de mobilité (OCBM), visé à l’article 1er bis, 8° du décret[2]. En effet, chaque commune wallonne détient une action de « catégorie B » qui lui a été attribuée en échange de ses participations dans le capital des anciennes sociétés d’exploitation.
Pour chaque bassin de mobilité, il est créé un organe de consultation chargé d’émettre, sur initiative propre ou à la demande de l’autorité organisatrice du transport, des recommandations concernant les modalités locales de traduction des orientations stratégiques, définies préalablement par l’autorité organisatrice du transport, compte tenu du contexte de l’offre, des besoins et du budget, et concernant tout autre mode de transport. Chaque organe de consultation de bassin de mobilité se réunit deux fois par an, à l’initiative de l’autorité organisatrice du transport et chaque commune y est utilement représentée.
C. Le contrat de service public entre la Wallonie et l’OTW 2024-2028
Ce contrat s’inscrit, comme le précédent, dans le cadre des priorités et des orientations globales poursuivies par le Gouvernement wallon exprimées dans la Vision FAST et dans la Stratégie régionale de mobilité. En effet, celui-ci a décidé de développer un système de mobilité global, dans lequel la part du transport collectif doit s’accroître fortement et passer de 4 à 10 % en 2030.
Par ailleurs, ce contrat comprend trois objectifs stratégiques :
- l’évolution de l’offre de transport : mise en exploitation des grands projets structurants régionaux, redéploiement des lignes existantes et d’un transport à la demande, renforcement de l’intermodalité;
- le renforcement de l’attractivité de l’OTW : fiabilisation du service quotidien (ponctualité, fiabilité des informations en temps réel…), optimisation du parcours client ;
- la responsabilité sociétale de l’OTW : décarbonation des flottes de véhicules, amélioration de l’accessibilité universelle des transports publics (en particulier pour les personnes à mobilité réduite), lutte contre le harcèlement, les violences sexistes et toute forme de discrimination.
La Région vise un redéploiement des lignes autour des réseaux structurants (urbains, Express, ferroviaires) ainsi que le déploiement d’un transport à la demande en concertation avec les pouvoirs locaux. L’objectif est d’élaborer un réseau hiérarchisé plus lisible et d’améliorer l’accessibilité au territoire que ce soit pour les zones plus rurales ou les pôles d’attractivité (hôpitaux, parcs d’activité économique, sites touristiques…). La mise en place de solutions de mobilité locale est également prévue afin de permettre un rabattement vers les pôles identifiés dans le projet de Schéma de Développement territorial et vers les mobipôles.
Le concept de mobipôles et mobipoints désigne un lieu physique relié au réseau structurant de transport en commun (bus, tram, train), où sera proposée une offre de transport diversifiée et vers laquelle convergeront des infrastructures de mobilité qualitatives et performantes. Selon les cas, il s’agira d’un parking de covoiturage, de voitures partagées, de stations de rechargement des véhicules (voiture, vélo…), d’abris vélo sécurisés, de locations de vélo, un lieu d’attente protégé et éclairé, voire des espaces de coworking, etc. Les mobipôles doivent permettre une meilleure combinaison et un meilleur confort pour le passage d’un mode de transport à l’autre, particulièrement avec le train. Ils participent donc à l’objectif de renforcement de l’intermodalité.
Pour améliorer l’intermodalité, la Région demande à l’OTW de mettre en œuvre une intégration physique, digitale et tarifaire de l’offre, dans une optique de complémentarité en particulier avec celles des autres opérateurs de transport public. Les nœuds de correspondance, en priorité avec le train, doivent également être optimisés.
La Région, via l’AOT, établit une planification stratégique du réseau de transport public en concertation avec l’OTW et pilote le processus de redéploiement de l’offre. Elle assure la concertation, avec les communes notamment, dans le cadre des OCBM afin de tenir compte des réalités locales. Elle veille également à la concertation des communes et de l’OTW pour l’établissement des mobipôles et mobipoints. La Région soutient par ailleurs les pouvoirs locaux dans l’aménagement et l’entretien des infrastructures de cheminements sécurisés en modes actifs et d’équipements des mobipôles.
D. Les partenariats entre les communes et l’OTW
Des partenariats entre les communes et l’OTW permettent de développer les services publics de transport et de proposer de nouveaux services de mobilité à la population.
La mise en place d'un bus local ou proxibus constitue l’exemple de partenariat en matière de transport de personnes et est notamment adaptée au milieu rural. Il permet aux communes de développer un service sur mesure correspondant aux besoins de sa population (transport vers le marché ou les services communaux, rabattement vers la gare, etc.) et complémentaire à l’offre régulière. Classiquement, le partenariat est le suivant : la commune prend en charge le coût du chauffeur, l’OTW met à la disposition de la commune le bus et une formation pour le chauffeur. Les autres frais (entretiens, carburants, etc.) sont répartis entre les partenaires. Le transport à la demande remplacera sans doute ce dispositif au fur et à mesure du redéploiement du réseau TEC.
Les communes peuvent également solliciter une aide financière du TEC pour le placement d’équipements de stationnement pour les vélos au droit d’arrêts de transport en commun bien choisis, c’est-à-dire, disposant d’un potentiel réel d’utilisation. L’intervention du TEC peut alors atteindre 80 % de la dépense, voire davantage puisque dans le cadre des lignes Express, c’est l’intégralité du financement des équipements vélos qui est prise en charge par le TEC[3].
D'autres types de partenariats importants peuvent encore être noués, notamment pour ce qui concerne les aménagements aux abords des gares, le respect des règles de stationnement sur les aires d'arrêts de bus, l'organisation de transport pour des événements ponctuels, etc.
2. Les services de taxis
En décembre 2024, le régime juridique applicable aux taxis en Région wallonne a subi une grande réforme[4]. La réglementation relative aux services de taxis est depuis régie par les textes suivants :
- Le décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité (M.B., 7.12.2023)
- L’arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant exécution du décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité (M.B., 21.8.2024).
Le collège communal est compétent pour délivrer, suspendre et retirer les licences d'exploitation pour un service de taxis sur le territoire de la commune. Le Gouvernement peut annuler, tout ou partie de l’acte octroyant la licence d’exploitation lorsque la commune n’a pas respecté la législation applicable.
Le conseil communal peut fixer les conditions d’exploitation dans les limites arrêtées par le Gouvernement.
3. Le transport à la demande
Le transport à la demande (TAD) regroupe une diversité de services de mobilité visant à répondre aux besoins non couverts par les transports collectifs classiques. Il se distingue par l’absence d’itinéraire fixe et d’horaire prédéfini. Le TAD constitue un complément aux transports structurants, dans une logique de rabattement (« first mile, last mile ») ou de porte-à-porte, notamment pour les personnes qui ont des difficultés à se mouvoir. Il contribue à une meilleure accessibilité du territoire, en particulier dans les zones peu desservies.
Le TAD s’adresse à l’ensemble des citoyens wallons, avec, selon les opérateurs, une attention particulière portée aux personnes à mobilité réduite, aux publics fragilisés et aux habitants des zones rurales et semi-rurales. Les motifs de recours au transport à la demande sont variés et nombreux : rendez-vous médicaux ou administratifs, courses, déplacements professionnels, formations ou activités, que ce soit de manière ponctuelle ou récurrente.
En Wallonie, le TAD est assuré par pas moins de 600 opérateurs, dont un tiers sont des opérateurs publics (CPAS, administrations communales, régies communales). Parmi les opérateurs privés, on retrouve des ASBL, des sociétés commerciales, des hôpitaux, la Croix-Rouge, des indépendants, etc. Certains interviennent sur un territoire restreint, tandis que d’autres couvrent l’ensemble de la Wallonie. Les obligations des opérateurs de TAD sont régies par le décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité (Titre 5 Des services de transport à finalité spéciale et Titre 6 Des services de transport à finalité sociale).
À l’échelle régionale, le TAD est coordonné par le SPW Mobilité et Infrastructures, qui a mis en place un logiciel de gestion ainsi qu’un numéro d’appel unique[5]. Le SPW-MI s’appuie sur les Centrales Locales de Mobilité (CLM), partenaires subventionnés chargés de la diffusion de l’information et du soutien au développement du secteur. Les CLM travaillent également en collaboration avec les opérateurs locaux de mobilité pour la planification des trajets. Il existe huit CLM, chacune opérant sur un territoire défini. Les services fournis par les CLM dans le cadre des missions prévues par leur arrêté de subvention sont gratuits pour les communes.
Les missions CLM s’organisent autour de trois grands axes. Le premier concerne la coordination des offres de TAD. Les CLM collaborent avec les opérateurs pour favoriser le développement du TAD sur leur territoire. Elles doivent maîtriser le secteur, actualiser une base de données des acteurs de la mobilité, diffuser les bonnes pratiques et informer sur les évolutions législatives et les innovations propres au TAD. Elles encouragent également l’utilisation de l’outil commun de gestion du TAD par les opérateurs, qu’ils soient publics ou privés.
Le deuxième axe est orienté vers le service aux citoyens. Les CLM assurent la gestion téléphonique du numéro d’appel TAD selon les codes postaux de leur zone d’intervention. Elles identifient les solutions de déplacement les plus pertinentes en collaboration avec les opérateurs locaux, afin de répondre efficacement aux demandes. Ce volet inclut aussi la promotion du numéro d’appel et la sensibilisation à une mobilité durable, alternative à l’usage individuel de la voiture.
Enfin, le troisième axe vise à développer l’offre de services TAD en concertation avec les acteurs locaux susceptibles de contribuer à son expansion. Les CLM encouragent une approche supracommunale permettant de mutualiser les services, d’optimiser les coûts et d’élargir les possibilités de déplacement. Elles doivent également consulter les communes pour identifier leurs besoins et propositions en matière de TAD.
Références utiles
- Décret du 29 mars 2018 réformant la gouvernance au sein de la Société régionale wallonne du transport et modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne (M.B. 16.4.2018).
- Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 portant approbation de la fusion des sociétés du Groupe TEC et des statuts modifiés et coordonnés de l'Opérateur de Transport de Wallonie (M.B. 7.8.2018).
- Contrat de gestion 2024-2028 : https://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/bus%20tram%20metro/contrat%20gestion/Contrat%20de%20Service%20Public%20OTW%202024-2028.pdf
[1] Rapport annuel TEC, 2023
[2] Décr. 21.12.1989 rel. au service de transport public de personnes en Région wallonne.
[3] https://www.uvcw.be/mobilite/articles/art-7851 et https://mobilite.wallonie.be/news/subvention-tec-stationnement-velo---procedure-simplifiee
[4] https://www.uvcw.be/mobilite/articles/art-9233
[5] 0800/54 621

Focus sur la commune
Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec le SPW-IAS pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.
Téléchargez cette fiche en PDF Découvrez l'ouvrage complet