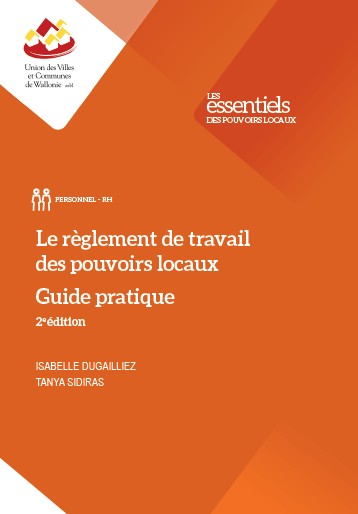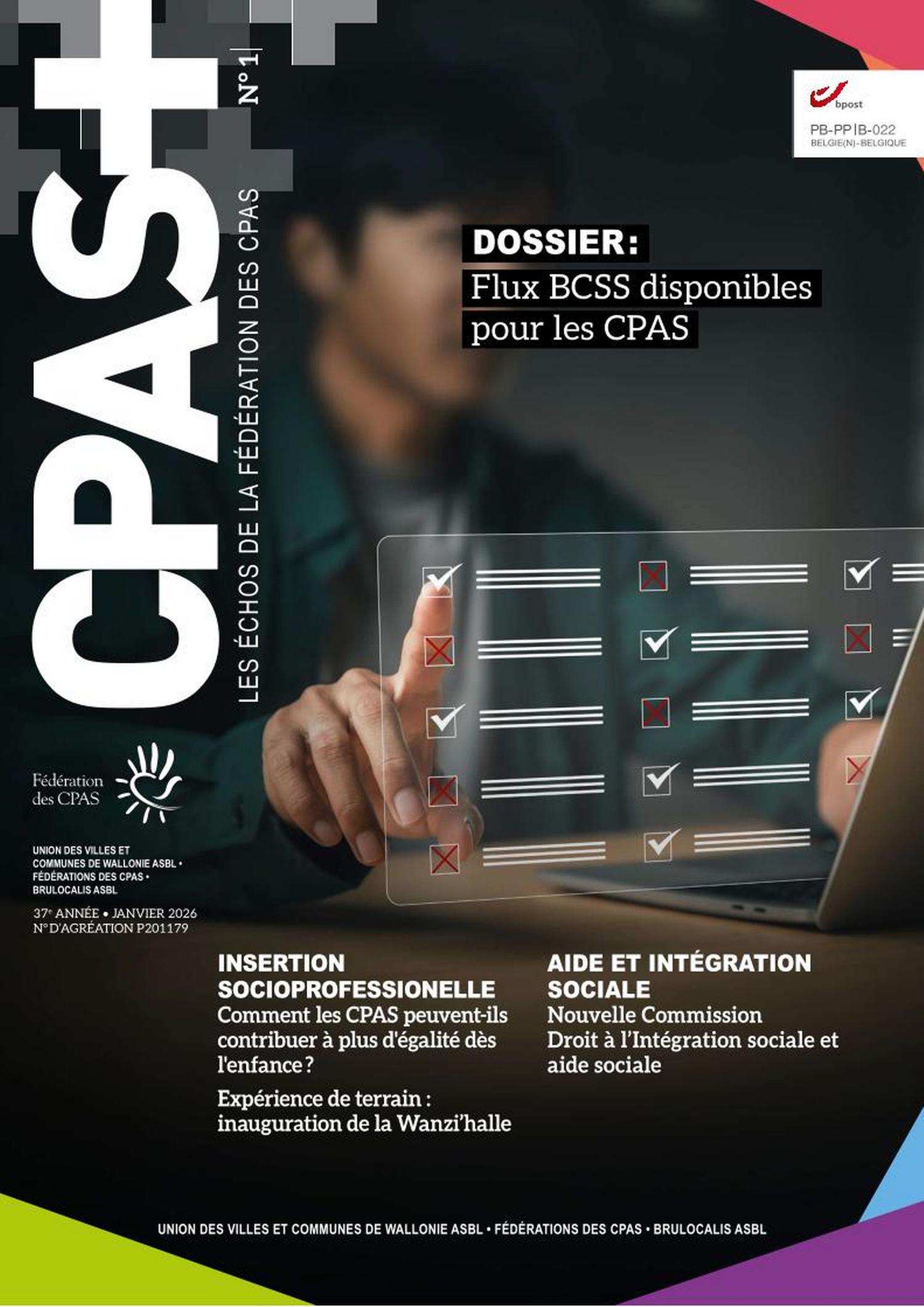Annulation d’un permis par le Conseil d’Etat alors que les travaux ont été réalisés : responsabilité et obligations des communes
Dans un arrêt du 6 mars 2025, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Cour ») considère que, suite à l’annulation de deux permis d’urbanisme portant sur des constructions existantes, l’autorité communale n’a pas déployé tous les efforts nécessaires pour rétablir leur légalité dans un délai raisonnable, de sorte qu’elle a privé l’article 6, §1er de la Convention européenne des droits de l’homme (qui vise le droit à un procès équitable – ci-après « la Convention ») de tout effet utile. Explications.
Saisi par le requérant, le Conseil d’État a annulé par deux arrêts distincts, deux permis d’urbanisme délivrés par la commune au voisin de l’intéressé, l’un concernait un premier entrepôt (arrêt de 2004) et l’autre un gîte rural et un second entrepôt (arrêt de 2009) construits en face de son habitation. Le 1er juillet 2011, la commune, statuant sur la demande initiale de permis d’urbanisme du voisin du requérant a délivré un nouveau permis pour le premier entrepôt en cause dans l’arrêt de 2004. En ce qui concerne les bâtisses litigieuses faisant l’objet de l’arrêt d’annulation de 2009, les parties se sont accordées devant la Cour sur le fait que celles-ci demeuraient en place en l’absence de permis.
Invoquant l’article 6, §1er de la Convention (droit à un procès équitable), le requérant se plaint de l’exécution tardive de l’arrêt du Conseil d’État de 2004 et de l’inexécution de l’arrêt de 2009, alors qu’il s’est adressé à différentes autorités afin de connaître l’évolution des dossiers et afin que les arrêts de 2004 et de 2009 fussent suivis d’effet.
Dans ce cadre, la Cour considère que :
- « (…) le droit à l’exécution des décisions de justice revêt encore plus d’importance dans le contexte d’un contentieux impliquant l’administration. La Cour rappelle à cet égard que l’administration constitue un élément de l’État de droit et que son intérêt s’identifie donc avec celui d’une bonne administration de la justice. Si l’administration refuse ou omet de s’exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdraient toute raison d’être. » (§20).
- « Il est vrai que, comme le relève le Gouvernement, les arrêts du Conseil d’État ne faisaient qu’annuler les permis d’urbanisme concernés et n’ordonnaient pas aux autorités nationales l’adoption d’une mesure spécifique. Cependant, le but même de ces recours en annulation était non seulement d’obtenir la disparition des actes litigieux, mais aussi et par voie de conséquence la levée de leurs effets » (§23).
- « La Cour observe à cet égard que le requérant s’est adressé à différentes autorités afin que les arrêts de 2004 et de 2009 fussent suivis d’effet (…). Or, malgré ces démarches, les arrêts du Conseil d’État sont restés sans suite pendant de nombreuses années. » (§24).
- Quant à l’arrêt de 2004, « (…) une nouvelle décision de la commune sur la demande de permis n’est intervenue qu’environ seize mois après l’arrêt de rectification. (…) Aucune justification n’a été avancée par le Gouvernement pour expliquer un tel délai. » (§26).
- Quant à l’arrêt de 2009, « La Cour rappelle cependant que les autorités sont garantes de la légalité, une exigence fondamentale de l’État de droit qui est au cœur de la Convention (…). Il leur incombait ainsi d’assurer le respect des règles de l’urbanisme qui visent à assurer un bon aménagement du territoire. Or la Cour constate qu’aucune démarche n’a été entreprise par les autorités nationales pour faire cesser l’illégalité en cause, qui perdure depuis de nombreuses années. » (§27).
La Cour considère, par voie de conséquence, qu’il y a eu violation du droit à un procès équitable prévu par l’article 6, §1er de la Convention.
Cet arrêt emporte concrètement l’obligation pour les autorités compétentes pour délivrer des permis de donner suite, dans un délai raisonnable, aux arrêts du Conseil d’Etat annulant de tels permis lorsque les actes et travaux y relatifs ont été réalisés, soit par le biais de la délivrance d’un nouveau permis, soit par l’entame d’une procédure de constat d'infraction urbanistique et ce, afin de rétablir la légalité et assurer une bonne administration de la justice. Les communes sont donc invitées à renforcer leur vigilance et leur réactivité dans le suivi des décisions juridictionnelles.
Arrêt CEDH 6 mars 2025
Notices inforum

Arrêt MONSEUR / Belgique [CEDH 6 mars 2025]
Lire aussi en Aménagement du territoire
Formations - Aménagement du territoire
- Le béaba du CoDT pour les communes
- Le Code du Développement territorial
- Le développement territorial
- Clés pour introduire une demande de permis public
- Focus sur la procédure d’expropriation
- Remise d’un avis en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire par votre CCATM
- Remise d’un avis relatif à un projet d’implantation d’habitations légères par votre CCATM
- La procédure d’instruction des demandes de permis et de certificat
- Le champ d’application des permis d'urbanisme
- Focus sur les sanctions et infractions en matière d’urbanisme
- Introduire une demande de permis public : points d’attention pour les services communaux en charge de l’urbanisme
- La motivation des actes en matière d’urbanisme
- La publicité administrative en matière d'urbanisme et d'environnement
- Le permis d’environnement en pratique
- Le plan de secteur
- Les outils locaux du développement territorial